- Imprimer
- Partager
- Partager sur Facebook
- Partager sur X
- Partager sur LinkedIn
Colloque / Recherche-création
Du 5 novembre 2025 au 7 novembre 2025
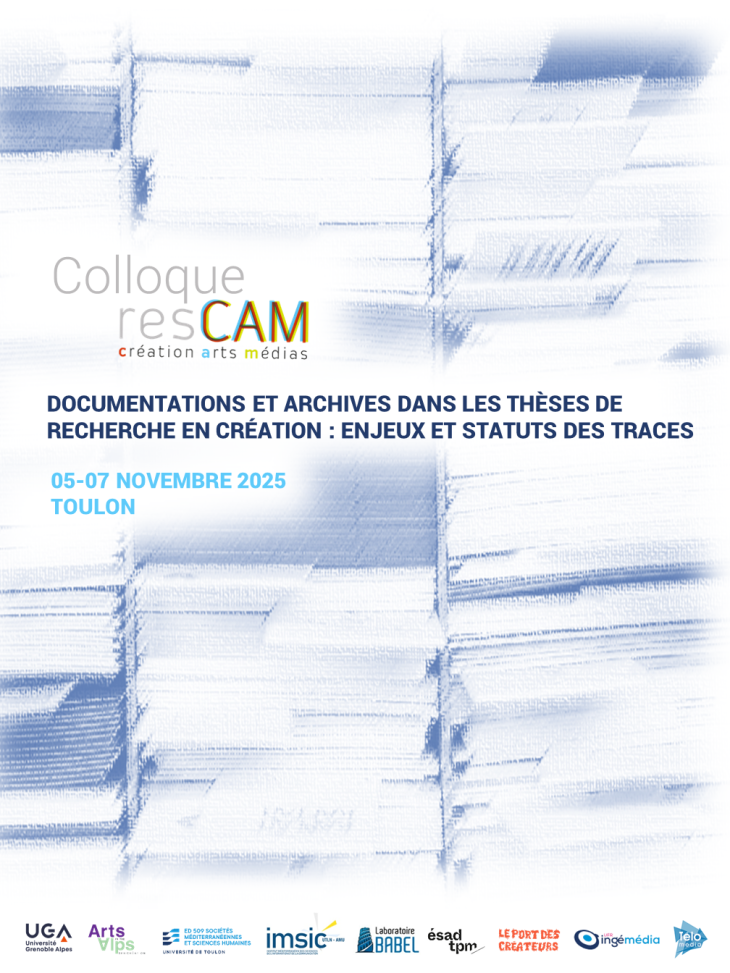
Ce colloque se pose comme objectif d’interroger les enjeux des outils de documentation, du statut des traces et des archives dans une thèse de recherche en création, recherche-création (RC) ou création-recherche (CR) – appellations représentatives qui n’excluent pas d’autres appellations existantes aujourd’hui en France ou dans l’espace francophone.
Cette thématique fait émerger des enjeux particulièrement sensibles au moment où plusieurs universités adoptent un label pour les thèses en création et donc au moment où la quantité de documents de toutes natures à analyser et archiver commence à augmenter.
Programme
Mercredi 5 novembre
Amphi FA001
13h30 | Accueil
14h00 | Ouverture du colloque
14h30 | Conférence « Constellations of re-membering: la voix de la pratique dans la thèse ». Marie-Louise CRAWLEY (Coventry University)
Session 1. Places et archivages des travaux de création – Modérée par Gretchen SCHILLER et Grazia GIACCO
15h30 | « Que faire des archives pré-doctorales ? Enjeux et statuts des traces antérieures à l’entrée en thèse ». Amélie LEJOSNE (Université de Strasbourg)
16h00 | « Les archives relationnelles de la recherche-création théâtrale ». Sam CORNU (Avignon Université)
16h30 | Pause
17h00 | « Documenter ou représenter le droit ? Archives et traces d’une recherche-création appliquée au droit ». Guillaume MARAUD (Université de Caen Normandie)
17h30 | « Archiver la recherche-création en arts du spectacle : restituer les traces, les corps et la mémoire collective. Critiques et perspectives sur la création d’Une lumière fantastique irradie le ciel et de La Turbine – là où la lave coule sur notre peau ». Théo MOINE (Université de Toulouse Jean Jaurès)
Jeudi 6 novembre
08h30 | Accueil
09h00 | Conférence « Fictions archivales sur les réseaux sociaux ». Alexandra SAEMMER (Université Paris 8)
Session 2. Dispositifs – Modérée par Michel DURAMPART et Louise NOEL
10h00 | « Ondes Ren@rdes / Sound Foxyness : artefacts radiophoniques comme archive auto-théorique ». Crystal ASLANIAN (Université Gustave Eiffel)
10h30 | « Les traces silencieuses : glaner, capter et archiver dans une démarche de recherche-création ». Océane MAIREAUX (Université Bordeaux Montaigne)
11h00 | Pause
11h30 | « Les Linéaments de la thèse : restitution du processus de recherche dans l’exposition et restitution de l’exposition dans la thèse ». Lula WYSS LE BROCQ, Juliana ZEPKA, Corinna KRANIG (Université Paris 8)
12h00 | « La soutenance d’une thèse recherche-création : un interlude pour les publics ? ». Lorelei DUPÉ (Université Bordeaux Montaigne)
12h30 | Repas
Session 3. Restitution du processus de création recherche – Modérée par Pierre KATUSZEWSKI et Méline ZAPPA
Téléomédia
14h00 | « Le journal de recherche comme espace de recherche- création ». Marina LEDREIN (Université Paris 8)
14h30 | « La place des archives dans un essai documentaire sur la mémoire des réfugiés de Varosha, la ville-fantôme de Chypre ». Cyril LAFON (Université de Poitiers)
15h00 | Pause
15h30 | « Documenter la carrière : la vidéo comme trace et écriture du terrain ». Elina MORENO (Université Bordeaux Montaigne)
16h00 | « Traces actives et hétérochronies opératoires : formes de documentation et savoirs situés dans une thèse en recherche-création musicale ». Maxence MERCIER (Université Côte d’Azur)
Vendredi 7 novembre
ÉSAD TPM – 2 Parvis des écoles, Toulon
08h30 | Accueil
Session 4. Traces et écriture, auto-écritures (partie 1) – Modérée par Valérie MICHEL-FAURÉ et Laura LÉVÊQUE
09h00 | « Garder trace : un danger pour la partie création de la recherche création ? ». Claire MUSIOL (Université Montpellier Paul Valéry
09h30 | « Laisser une trace pour faire chemin, témoignage d’une création-recherche en design ». Pauline MUNOZ (Université Toulouse 2)
10h00 | « De la mémoire dormante à l’archive spéculative : expérience d’une activation documentaire ». Manon RECORDON (Université de Toulouse Jean Jaurès)
10h30 | Pause
11h00 | « Quelles traces de l’activité de recherche au sein de l’objet-thèse ? ». Margaux MOUSSINET (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
11h30 | « Créer en et hors terrains militaires : la stratégie de la collecte ». Estelle BOUCHERON (Université de Strasbourg)
12h00 | Repas
Le port des Créateurs – Place des Savonnières, Toulon
Session 5. Traces et écriture, auto-écritures (partie 2) – Modérée par Catherine MILKOVITCH-RIOUX et Gaëtan RIVIÈRE
14h00 | « ” Vos papiers s’il vous plaît ” : vraies histoires, faux documents ». Daniel JABLONSKI (Cergy Paris Université)
14h30 | « Le processus de création comme dispositif d’archivage vivant : entre ateliers d’exploration scénique et mise en scène ». Mona DAHDOUH RECORDIER (Université Rennes 2)
15h00 | Pause
15h30 | « L’usage de l’archive dans un processus dramaturgique. Mise en forme de la recherche et laboratoire des affects ». Éloïse DE NAYER (Université de Poitiers)
16h00 | « Des archives co-affectives aux objets poétiques : le montage comme dispositif de génération du paysage ». Chong ZHENG (Université de Toulon)
16h30 | Clôture du colloque
Les conférencières
Marie-Louise CRAWLEY est danseuse et enseignante-chercheuse en danse à l‘Université de Coventry au Royaume-Uni.
Elle a fait des études à l’université d’Oxford avant de suivre une formation à l’école du mime Marceau à Paris puis d’intégrer le Théâtre du Soleil en tant que comédienne (2003-2009). Elle a ensuite travaillé en tant que chorégraphe et danseuse au Royaume-Uni (2010-2015) avant de faire sa recherche doctorale (recherche-création) sur la danse au musée (2015-2018) au Centre for Dance Research, Coventry University, où elle est maintenant Assistant Professor.
Ses publications incluent avec Whatley, S., Racz, I., Paramana, K. (2020) Art and Dance in Dialogue: Body, Space, Object (Palgrave Macmillan) ; « The Fragmentary Monumental: Dancing Female Stories in the Museum of Archaeology » in ChoreoNarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and beyond, édité par K. Schlapbach et L. Gianvittorio-Ungar (2021) ; « Dance as Radical Archaeology », Dance Research Journal 52(2), pp. 88-100 ; « ” This a different angle ” : Dancing at the Louvre », Danza e Ricerca 12(12), 283-296. Son livre Radical Archaeology: Dancing in the Museum va paraître prochainement chez Routledge.
Elle est porteuse du projet Kinaesthetic Heritage: bodies, memory, contested histories subventionné par le British Council en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes.
Alexandra SAEMMER est professeure des universités en sciences de l’information et de la communication à l’UFR « Culture et communication » de l’Université Paris 8 et chercheuse au Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (CEMTI).
Ses recherches portent sur la production du sens dans les artefacts culturels numériques, en particulier sur les convergences et champs de tension entre les contextes de production, l’anticipation des pratiques par les matérialités de l’artefact et les processus de réception (terrains : presse en ligne, publicité, e-albums culturels, littérature numérique, applications éducatives, réseaux socio-numériques, manuels…). Les formes et figures des artefacts numériques sont étudiées dans une démarche de sémiotique critique qui s’intéresse tout autant aux matérialités des dispositifs (design éditorial, “architextes” logiciels, code) qu’aux stratégies discursives et à leurs motivations. Elle consacre également ses travaux à la littérature numérique en appui sur des démarches de recherche et création.
D’origine allemande et descendante des Sudètes (un peuple sans pays, expulsé de Tchécoslovaquie à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir voté en faveur de son intégration dans l’Allemagne nazie), Alexandra SAEMMER a publié aux éditions Bayard le 10 septembre 2025 l’ouvrage Les zones grises. Enquête familiale à la lisière du Troisième Reich qui retrace l’histoire de sa famille. Entre archives et entretiens, l’auteure a également réalisé un travail ethnographique au sein de groupes Facebook où la communauté sudète se raconte, à l’abri des regards.
Comité d'organisation
Billel AROUFOUNE (Univ. de Toulon)
Nawal BAKOURI (ESADTPM)
Philippe BONFILS (Univ. de Toulon)
Julien CARBONE (Le Port des Créateurs)
Vincent CHAUVET (Univ. de Toulon)
Sam CORNU (Avignon Univ.)
Michel DURAMPART (Univ. de Toulon)
David GALLI (Univ. de Toulon)
Clara GALLIANO (Univ. de Toulon)
Grazia GIACCO (Univ. de Strasbourg)
Laure LÉVÊQUE (Univ. de Toulon)
Virginie MEUNIER (Univ. Grenoble Alpes)
Catherine MILKOVITCH-RIOUX (Univ. Clermont Auvergne)
Louise NOEL (Univ. de Toulon)
Franck RENUCCI (Univ. de Toulon)
Richard RENTSCH (Univ. de Toulon)
Gaëtan RIVIÈRE (Univ. de Toulon)
Gretchen SCHILLER (Univ. Grenoble Alpes)
Méline ZAPPA (Univ. Clermont Auvergne)
Colloque organisé pour le resCAM par l’École Doctorale 509 de l’Université de Toulon, avec le soutien de l’IMSIC, BABEL, Ingémédia et Télomédia, en collaboration avec l’ESADTPM et Le Port des Créateurs, et sous la responsabilité de Franck RENUCCI.
Date
Localisation
Université de Toulon
Télécharger
Programme (PDF, 924.5 Ko)
ResCAM
- Imprimer
- Partager
- Partager sur Facebook
- Partager sur X
- Partager sur LinkedIn